
|
Je ne crois pas que l’on appartienne à un pays. Encore moins à une région, tant celles pour lesquelles on s’est tantôt étripé ont d’artificiel et de fortuit. La Picardie plus que pas mal d’autres. C’est déjà dans la revendication régionaliste que commence le sinistre et vichyste fiasco de l’identité nationale version Sarkozy and co. C’est que la politisation du territoire n’a que peu à voir avec l’intime, avec le ressenti, non plus qu’avec l’Histoire. L’Aisne du Chemin des Dames a plus de proximité avec la Lorraine de Verdun qu’avec la Picardie des cathédrales, fût-ce celle de Laon. Mais l’écriture, direz-vous, les écrivains du terroir, ça existe ? Non ! Du terroir, je connais des vins, des saucissons, de la boustifaille mais pas de littérature. Jamais aucune littérature n’a été « de terroir ». En Picardie, où j’ai quand même beaucoup traîné mes guêtres en soixante ans, je ne suis jamais tombé sur rien de tel. Les gens qui se revendiquent d’une telle appartenance, « écrivains de terroir », usurpent le premier substantif. Brassens les a chantés comme il convient, « les imbéciles heureux qui sont nés quelque part »… Nous avions toutes ces réflexions en tête quand, à quelques-uns, nous avons créé, il y a dix ans, l’association « Ecrivains en Picardie », en veillant bien au « en » qui vaut bannissement absolu du « de ». C’est pourquoi les territoires littéraires que j’arpenterai ici révéleront inévitablement qu’il n’y a nulle identité picarde et que seul le hasard des naissances et des voyages fait voisins les amis dont les noms apparaissent. Ceci dit, je n’exonérerai pas pour autant les politiques de leurs responsabilités en ce qui concerne le nécessaire soutien à la création littéraire. Je dis ceci dans une région qui fait bien peu, si peu qu’elle a même soigneusement enterré le projet de création d’un Centre régional du Livre qui était pourtant une manière de minimum. La Picardie n’aura donc pas la moindre des choses en la matière. A la place, on nous sert un attachement obsessionnel et pervers pour les octogénaires. C’est que dans les quatre-vingts ans de Pierre Garnier de 2008, ce n’est pas tant la littérature qui intéresse que la communication, la surface médiatique, bref, le hors-texte. Je le dis sans ménagement car Pierre n’a nul besoin de reconnaissance et n’est pas dupe de ces éloges publics. La poésie, la littérature sont de l’ordre d’une relation personnelle à la langue. Et tout le reste n’est que slogan. Non. Seules m’intéressent les rencontres de ces années-ci avec des écrivains d’aujourd’hui. Qui se trouvent donc, définitivement ou momentanément, accidentellement ou sciemment, axonais, isariens ou samariens. Picards ? Pas au sens de la langue – la langue picarde – puisque je ne la parle ni ne la comprends et n’ai donc, à son égard, qu’un intérêt… ethnographique, comme je l’ai pour tous les sabirs, charabias et volapüks en quoi l’on s’exprime de par le vaste monde, y compris le kashgâr qui est, comme on le sait, au moins aux alentours, la langue des Tcherkhâns et de Kurgâr-le-Sage .
|
|
Six poètes
|
||
 |
Gérard Fournaison Les premiers dont je fis la connaissance furent des poètes. Gérard Fournaison et Denis Dormoy. L’amitié qu’ils se portaient – se portent – me les rend quasi indissociables bien que leurs écritures soient très différentes. J’avais vingt et quelques. Je découvris la poésie en même temps que la chanson et que quelques autres de ces choses qui sont indispensables pour donner de l’écho à nos vies : les femmes, les amis et la bière. Bienheureuse décennie ! Gérard et Denis écrivaient déjà – moi, pas – et animaient une revue tout à fait remarquable, Le Lumen. Ils publiaient des écritures qui, par leur modernisme, par leur audace, tranchaient alors avec les courants qui m’étaient familiers – pour l’essentiel, l’école de Rochefort. Des noms ? Jacques Demarcq, Jean-Luc Lavrille, Sylvie Nève, Mario Lucas… Le Lumen bousculait mon approche classique, pour tout dire scolaire, du poème. Denis participait aussi à l’aventure lancée par Jacques Darras : la revue In’hui. C’est donc très naturellement que je lançai, avec des amis, successivement Au pied de la lettre qui dut connaître trois numéros et Pli qui en connut un peu plus. Mais je découvrais la chanson – celle que l’on écrit et ce fut un joli foisonnement, de 73 à 83, avec le groupe Jeff. Les deux mêmes lancèrent ensuite les éditions G&g, Grammaire & Graphies, qui éditèrent des poètes en nombre mais aussi, avec moi, nouvelles et romans. |
|
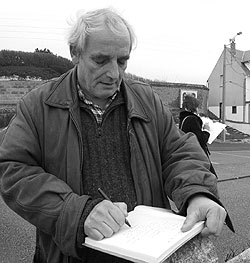 |
Denis Dormoy Très différente l’écriture de Denis Dormoy, même si l’on trouve, chez le professeur d’IUFM, le même goût de se frotter aux limites extérieures du pays littéraire. Denis écrit volontiers, épaule contre épaule avec un plasticien (avec Marc Gérenton, « Mangeurs d’astres », éd. Rencontres, 2001) ou un photographe (Fred Boucher, « Petites histoires », Les Imaginayres, 2003). Parmi les nombreuses publications de Denis, je voudrais aussi citer « PerSonne » (G&g, 1998), magnifique évocation du « personne » de Péronne, où est situé l’Historial de la Grande Guerre. Dans « Mangeurs d’astres » il mêle ses propres mots à ceux de lettres de poilus et, entre le passé et le présent, entre le mort et le vivant, il se produit véritablement une déflagration qui éclabousse de poésie les champs labourés par les mines et les obus. L’effet est saisissant. Denis sait aussi manier la délicatesse pour évoquer la baie de Somme (« Le tremblé des pas », sur des photos de Maxime Godard, Cadastre8zéro, 2005). Je ne lui connais qu’un seul texte en prose de quelque importance, une nouvelle pour tout dire, « Chassé-croisé » (G&g, 1999). Je commençais tout juste à écrire et prenais part à des concours de nouvelles. Un jour Denis me donna le manuscrit de cette nouvelle. Je ne sais plus avec exactitude quel en était le thème mais j’ai le souvenir de souterrains et de choses très mystérieuses liées à la guerre. Et surtout d’une construction incroyablement entremêlée : tout à fait ce que je cherchais pour raconter l’histoire que j’avais en tête. Je plagiai sans vergogne son découpage scénaristique et écrivis ainsi « La chanson de Carco » qui me valut le 1er prix du Concours de L’Huma en 96 ; la nouvelle a été publiée dans « 33 tours » (HB éditions). Un très beau soir d’été, Denis et moi nous fîmes un plaisir à nul autre pareil : dans le petit théâtre d’argile de Michel Fontaine, à Maisoncelle-Saint-Pierre, près de Beauvais, nous lûmes nos deux textes successivement au milieu d’un public d’amis. Une soirée rare qui me convainquit du bonheur des lectures – ce dont, désormais, je ne me prive plus.
|
|
|
Jean-Louis Rambour Je fis, quelque temps après, la connaissance de Jean-Louis Rambour. Je tombai tout de suite sur des livres qui me sont restés « de chevet », comme « Théo » (Corpus, 96) dans lequel il évoque le souvenir de son grand-père, Poilu de la Grande Guerre. Ce livre, on ne peut le lire sans entendre les voix qui le traversent et j’appris par la suite que Jean-Louis en avait fait lui-même des lectures. J’aime, chez lui, cette poésie directement liée à la vie, issue d’elle. De Jean-Louis je voudrais tout citer, et citer aussi sa prose, « Les douze parfums de Julia » qui sont une splendeur de délicatesse (La Vague Verte, 2000) et, parce que l’homme est un pince-sans-rire, le « Et avec ceci » homérique dont il gratifia les éditions Abel Bécanes (2007). J’oubliais, et ne me le serais pas pardonné, le superbe recueil à deux voix écrit avec Pierre Garnier, « Ce monde qui était deux » (Ed. des Vanneaux, 2007). Encadré sur Jean-Louis Rambour
|
|
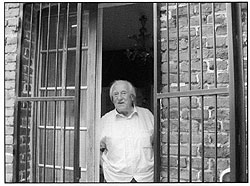 |
Pierre Garnier De Pierre Garnier je dirai peu. Parce que l’homme est connu. De moi, il l’est depuis une dizaine d’années seulement. Depuis ce soir où, au théâtre de Beauvais, Gérard Fournaison et Denis Dormoy l’accueillirent, avec ses textes magnifiques sur la Révolution russe et les engagements de la jeunesse. Disons-le d’emblée : c’est ce Pierre-là qui me touche et m’émeut et me transporte. Le Pierre Garnier qui, avec les mots les plus simples qui soient, dit tout aussi bien la grandeur d’un paysage rural (« Les poèmes de Saisseval », 92 ; ou « Une enfance », G&g, 2000). En revanche l’aventure spatialiste qui fut mise à l’honneur en 2008 par le Conseil régional me laisse totalement indifférent, bien que Pierre lui-même semble y attacher une grande importance. Je n’y vois guère qu’une trouvaille, ou une « bizarrerie », et rien de ce que j’ai pu lire ne m’a convaincu. C’est très clairement pour moi une voie sans issue. Même « Le poète Yu » (allemand/français, Aisthesis Verlag, 2006) largement cité par Pierre lors de la soirée qui lui fut consacrée à la Maison Jules Verne , m’apparaît une… aimable facétie… Non. Mais du Pierre Garnier qui s’exprime avec les mots, on peut tout lire. On peut plonger à volonté dans une œuvre gigantesque (dans les deux cents ouvrages, non ?). Encadré sur Pierre Garnier La première fois où j’ai rencontré Pierre Garnier, c’était un printemps. L’année n’a pas d’importance mais il était encore très jeune. Remarquez ça ne vous dira rien parce que Pierre est toujours très jeune. C’est bien ça le drame avec les gens comme lui : on ne leur donne pas d’âge. Quel âge voulez-vous donner à quelqu’un qui peut écrire : Il n’y a pas de village plus âgé que l’enfance / Dans la bicyclette la campagne rayonne / On la voit monter sur les collines / Puis, la roue allant plus vite, / Les rayons s’effacent / Et les champs et les prés rayonnent / La bicyclette va si vite / Qu’on ne sait jamais si elle suit / Un sentier ou le lit d’un ruisseau / Où elle se mire.
|
|
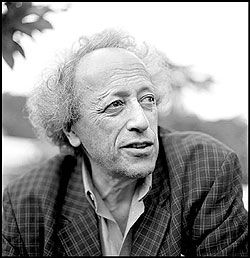 |
Bernard Noël Si Pierre Garnier fut fêté par la Picardie en 2008, ce sera Bernard Noël en 2010. Le même prétexte donc dans les deux cas : les 80 ans. Jean-Louis Rambour et moi trouvions l’idée si saugrenue que nous fêtâmes les nôtres par anticipation, au début juillet 2009 – Jean-Louis anticipant d’ailleurs plus que moi. A cette occasion nous présentâmes, maquettes à l’appui, les ouvrages que nous avions le projet d’écrire d’ici notre huitième décennie. Et, depuis, nous essayons tant bien que mal de mettre en œuvre notre programme : pour lui, entre autres, « Quitter sans crier gare », « Leçon de choses », « L’ahan, dictionnaire des mots à hiatus » ; pour moi, de plus significatif, « Petit précis de menuiserie », « Car j’avais même un nom que vous n’entendrez plus » ou « Cancans et froufrous, dictionnaire à usage des bègues ».
|
|
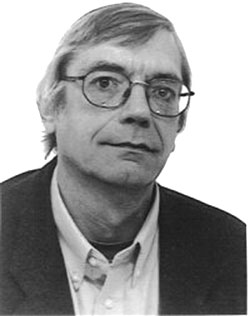 |
Gilbert Desmée Il a pris récemment la présidence de l’association « Ecrivains en Picardie ». Il a dirigé la revue Sapriphage de 1987 à 2001, une revue exigeante, rigoureuse, qui a fait la part belle à la poésie belge. C’est lors de la promenade Pierre Garnier dans le quartier Saint-Roch que je fis vraiment sa connaissance. Il avait écrit un texte très joli sur l’oncle résistant et réalisé une véritable performance sonore en imitant le bruit des mitraillages aériens. Beaucoup des recueils de Gilbert sont aujourd’hui indisponibles. De L’arbre à paroles, « En écho des corps d’écriture » est toujours accessible. Ce qui frappe dans ce bref recueil, c’est le lourd mystère, « l’obscur », qui demeure non pour clore l’accès au poème mais au contraire pour ouvrir des champs d’interprétation. La langue est simple, le lexique est commun, mais les ellipses de la syntaxe, qui sont le propre de la poésie, laissent la pensée vagabonder et, plutôt que la pensée, la sensibilité patiente et attentive. Car c’est une poésie très sensuelle, vibrante de sensualité – le mot « corps » - « jusqu’au sexe de l’aube scandée ». L’écriture procède par brefs groupes de mots, dans lesquels les verbes sont d’action et les adjectifs rares. Un dynamisme, une pulsion peut-être.
|
|
Six romanciers Quittant la poésie, je gagne les terres romanesques qui me sont plus familières. Comme toute région, de nombreux livres s’éditent chaque année. On estime à environ soixante-dix quatre-vingts le nombre de gens édités – hors travaux historiques et recherches universitaires. Parmi ceux qui me sont familiers je retiendrais volontiers les six noms qui suivent.
|
||
 |
Philippe Crognier Les jours où ça tangue, je vais volontiers à Gouy . Je sais que je peux arriver les mains vides. Il y aura son sourire, sa dégaine, ses formules faussement paysannes dont ses livres disent qu’elles ne le sont sans doute pas faussement, comme « La solitude, c’est un métier ». Voilà, c’est définitif. Comme une chose posée là, en évidence. Ce n’est pas le genre de gars à tourner autour du pot, pas le gars à finasser. Ses personnages sont tranchés, francs « comme du bon pain ». Il aime le bon pain, Philippe. Et moi j’aime ses livres. Tous. Les sept – mais, s’il faut choisir, « Grand Jules » (La Vague Verte, 2001) et « Tête de piaf » (Abel Bécanes, 2007) – et celui qui va bientôt sortir au Petit Véhicule et pour lequel j’ai écrit cette postface. Ah oui, ceci encore, pour bien comprendre ce qui suit : avec Philippe Crognier, nous avons commis plusieurs ouvrages sous le pseudonyme commun d’Angel Reinhart… Est-ce la tentation du roman ?, on cherche toujours à déceler, dans un recueil, ce qui en fait l’unité thématique ou au moins l’architecture interne : par quelle logique on passe d’un texte à un autre, comment ces deux-ci se répondent, de quelle manière ces deux-là éclairent une même situation sous des angles différents.
|
|
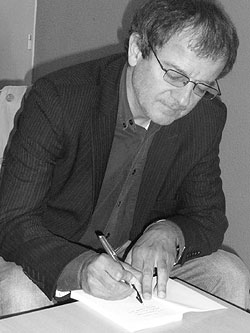 |
Philippe Lacoche Il est sans aucun doute le romancier le plus en vue de Picardie. Il publie beaucoup, au Castor Astral, chez Mille et une nuits, aux éditions du Rocher. Des nouvelles et des romans. Il vit et travaille dans la Somme – il est journaliste au Courrier Picard, en charge de la rubrique littéraire – mais il revendique son Aisne natale dont « la gare de Chauny est la plus belle du monde ». Tergnier, où il grandit, est la matière de son premier recueil de nouvelles, « Cité Roosevelt », paru au Dilettante (93). Michel Crépu (L’Express) a parlé à son égard d’un talent d’ « aquarelliste ». On ne saurait mieux dire. Philippe est l’homme des demi-teintes, des petits matins blafards, « des filles à peine touchées » et des coups de blues. Il a une sorte de gaucherie touchante dans les sentiments qui court tout au long de son œuvre pour culminer dans un personnage de quinquagénaire amoureux d’une jeunesse et bientôt par elle largué. Une « mélancolie » écrit Crépu, on pourrait aussi risquer un « désenchantement ». Car, même si le rock a beaucoup alimenté ses chroniques et ses livres (il faut absolument lire le si merveilleusement tendre « Tendre rock », Mille et une nuits, 2003), le ton qui lui colle à la peau est le blues. Dans « Des petits bals sans importance » (Le Dilettante, 97), le narrateur se met en quête de remonter le fil du temps pour comprendre de quoi est mort Rico, avec qui il courut la campagne pour animer les bals. Philippe excelle dans les personnages doux-amers, « fragiles, incertains, sûrs de rien, qui ont eux aussi rêvé, désiré et aimé ». J’ai beaucoup aimé « Les yeux gris » (Le Castor Astral, 2006), un roman que je tiens pour majeur dans son œuvre. Ce qui frappe dans sa galerie de personnages, c’est leur absence d’engagement politique : ils sont tout entiers plongés dans une expérience existentielle de la vie, dans le drame des sentiments, dans le ressenti. Philippe ne cache pas sa proximité – littéraire, politique, mais aussi dans leur façon d’être, je l’ai lu souvent sous sa plume journalistique – avec les « Hussards » que furent Nimier, Blondin, Kléber Haedens… dont le grand combat fut de s’opposer à Sartre et à l’écrivain « engagé », engagés qu’ils étaient à droite, voire à la droite extrême. Or, pour la première fois, me semble-t-il, dans « Les yeux gris », Philippe crée des personnages dont la vie incertaine et presque clandestine tient à leur engagement « révolutionnaire » comme porteurs de valises du FLN. J’ai été très intéressé de le voir délaisser ses territoires habituels d’écriture même si la guerre d’Algérie est, somme toute, peu présente dans le roman : c’est moins la réalité historique et militante qui est traitée que son image romantique. Oui, je crois que c’est cela qui m’a tant touché dans « Les yeux gris » : que Philippe prenne quelques risques avec son image en quittant, provisoirement, le personnage de roman qui lui ressemble tant.
|
|
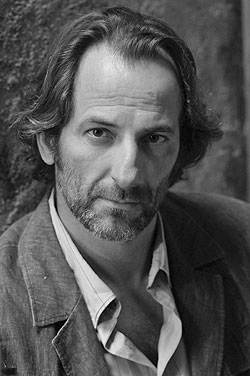 |
Patrice Juiff Un jour, je fus mis en contact avec un « jeune auteur », par ailleurs comédien, a qui on avait parlé de notre association d’écrivains. Il avait écrit un seul livre, « Frère et sœur », chez Plon. « Quelque chose d’absolument étonnant, inattendu, magnifiquement brutal ». Patrice Juiff était également comédien et on le voyait assez régulièrement dans des feuilletons télévisés – lui-même ne met pas en avant ce travail de comédien, il semble même presque s’en défendre ; il a tort : il soigne ses personnages et leur apporte beaucoup de vérité. En 2006, son second roman, « Kathy » (Albin-Michel) confirmait toutes les qualités du premier : une science particulière (sans doute liée à la pratique du cinéma) pour la scénarisation, le choix d’une ambiance très noire (idem), un mélange de provocation et de dureté tranchante. Dans les deux cas, les situations sont tirées de faits divers « sordides » : personnages marginalisés, vivant dans un huis-clos meurtrier. Ce n’est pas le plus intéressant du travail de Patrice : c’est essentiellement par son style que ses livres valent. Evidemment. Un style très fluide, avec des phrases courtes, la priorité donnée au descriptif et au narratif éliminant tout jugement moralisateur. Le recueil de nouvelles paru en 2008, « La taille d’un ange » (Albin-Michel) lui a valu le Grand Prix SGDL de la Nouvelle. Ces nouvelles de la violence ordinaire, de la dérive ont imposé un écrivain et son écriture. Avec un risque cependant, le même qui nous guette tous : de nous enfermer dans les univers que le lecteur attend de nous. C’est là, précisément, qu’il faut écouter ce que Jean-Pierre Cannet, « Picard d’adoption », a à nous dire : écrire ce n’est pas cultiver (un style, un univers, des personnages…), c’est défricher. Toujours. Je fais confiance à Patrice pour m’étonner. En 2010.
|
|
 |
Isabelle Marsay Serait-elle un écrivain cherchant sa voie ou bien l’aurait-elle trouvée dans la diversité même de ses écritures ? Toujours est-il qu’Isabelle Marsay ne cesse de me surprendre. A peine s’est-on habitué au ton faussement naïf et ingénument pervers de ces premiers romans (dont « L’instant C », Balland, 2000, qui lui vaut le Prix du Livre de Picardie) qu’elle se mue en enquêtrice coureuse d’archives pour évoquer « Le fils de Jean-Jacques » (Balland, 2002), entendez de Jean-Jacques Rousseau dont on sait qu’il confia ses cinq enfants à l’Hospice des Enfants-Trouvés. L’aîné, ainsi abandonné en 1746, sera envoyé en Picardie où il ira de nourrice en nourrice. Le père lui-même finira ses jours à Ermenonville (Oise). Un roman historique très probant. Nouvelle volte-face avec « Petits défis de la vie ordinaire » (L’Harmattan, 2008) : des nouvelles dans lesquelles Isabelle retrouve une plume vive, acerbe, de caricaturiste de l’époque et des mœurs, comme on dit, « provinciales ». Mais en publiant tout récemment « Pâques, la complainte d’une île » (Ed. Myriapode) elle semble s’être trouvé un ton : pas celui de la romancière à proprement parler, plutôt celui de la conteuse ou de la fabuliste, la réflexion philosophique, en tout cas sociale, se mêlant au récit. Elle « confirme son aptitude à s’appuyer sur le passé pour dire autrement le monde d’aujourd’hui en semant çà et là ses propres questions existentielles » (in « Encres vagabondes »). C’est parfaitement vu. Je pense toutefois qu’elle a des réserves d’éclats de rires qui trouveraient à s’exprimer dans la brièveté de la nouvelle.
|
|
 |
Dominique Cornet C’est par la petite maison d’édition Cadastre8zéro que je fis la connaissance de Dominique. Enseignant comme moi, comme moi en Segpa. Je m’étais intéressé aux Chinois qui vécurent et, pour quelques centaines, moururent à Nolette. Il réussit à passionner ses seize élèves pour les mêmes destins tordus de Chinetocs et cela scella notre amitié. J’appris après qu’il écrivait. Je lus un peu plus tard ce qu’il écrivait. On le reconnaissait tout à fait à travers ses textes : de la générosité, un souci d’harmonie dans la vie, la nature… C’était des nouvelles. J’ai tout de suite aimé ses nouvelles, leur ambiance rurale à la Bosco – j’exagère mais il y a de ça, c’est d’ailleurs lui qui, le premier, me parla de Bosco que, depuis, j’ai lu. Il travailla avec Jean-Pierre Cannet – qui est si souvent en Picardie que j’aurais presque pu, sans tricher, le faire passer pour un des « nôtres ». Jean-Pierre a préfacé le premier recueil de nouvelles qu’a publié le Petit Véhicule : « La pluie sur l’île » (2009). Encadré sur Dominique Cornet
|
|
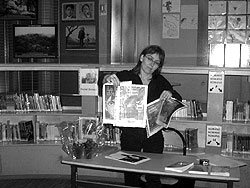 |
Ella Balaert Pour « le fun » j’aime à citer Daniel Boulanger, ce grand nom de la littérature, car de Compiègne (Oise) il est natif et de Senlis (Oise) résident. Pour le reste, je l’ai rencontré une fois. J’animais alors la rédaction d’une petite revue pédagogique départementale et nous avions, avec deux ou trois enseignants, le projet de l’interviewer sur la lecture à l’école. Il nous reçut avec une gentillesse confondante, fit mine de ne pas s’offusquer de notre inculture et donna à ses réponses l’intelligence et la sensibilité qui manquaient à nos questions. Bref, il nous donna du talent. J’aime mieux ses nouvelles que sa poésie, et mieux ses scénarios que ses romans. Il a écrit cette phrase qui comble le casanier que je suis : « Les plus beaux voyages se font par la fenêtre ». Pour le reste, Gallimard et Folio.
|
|
Roger WALLET janvier 2010 |


